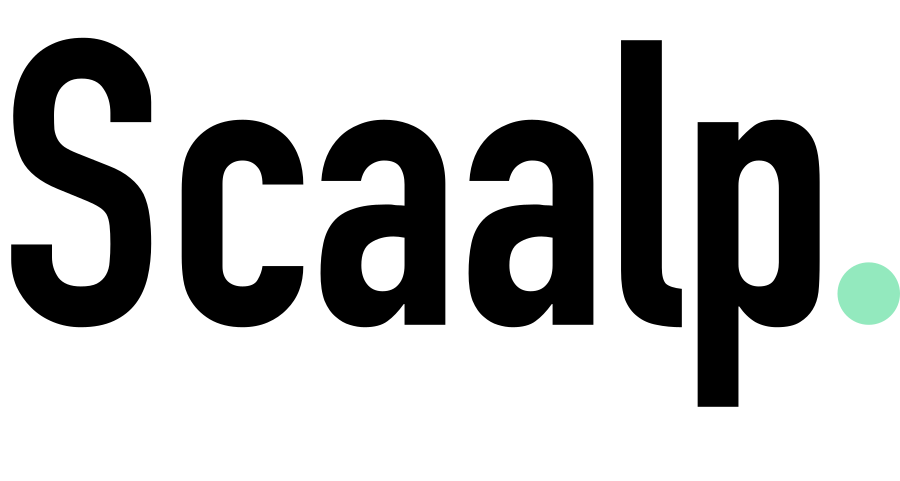La fin du greenwashing : comment gagner à l’ère de la preuve
Le “greenwashing” — ou écoblanchiment — a longtemps constitué une tentation pour les directions marketing : une esthétique verte, quelques slogans engageants, et l’image d’entreprise responsable semblait acquise. Mais cette époque est révolue.
Dans un contexte où les consommateurs sont de mieux en mieux informés, où les régulateurs renforcent leurs exigences en matière de transparence, et où les investisseurs conditionnent leurs financements à des engagements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) tangibles, le greenwashing n’est plus un artifice stratégique. C’est une ligne de faille, susceptible de faire s’effondrer en quelques jours une réputation construite sur des années.
Le basculement est profond. Il ne s’agit plus de dire que l’on fait bien. Il faut le prouver. À l’ère de la transparence radicale, la communication responsable repose sur la preuve, pas l’intention.
Le greenwashing : une stratégie désormais toxique
Une érosion massive de la confiance
Le greenwashing n’est plus perçu comme une simple exagération marketing : il est aujourd’hui considéré comme une forme de désinformation par une majorité de consommateurs, de régulateurs et d’investisseurs. Selon le Kantar Sustainability Sector Index 2023, 52 % des consommateurs dans 33 pays ont récemment constaté des allégations écologiques trompeuses, tandis que 67 % craignent que les marques agissent uniquement par calcul commercial [Source]. En parallèle, une enquête KPMG au Royaume-Uni révèle que 54 % des consommateurs refusent d’acheter des produits d’une marque reconnue coupable de greenwashing [Source]. Une étude complémentaire menée en 2025 montre que seulement 20 % des consommateurs estiment les déclarations durables sincères, tandis que 26 % remettent en cause les affirmations RSE et s’en méfient au point d’investiguer eux-mêmes [Source].
Cette méfiance croissante se traduit par des conséquences tangibles. Plusieurs entreprises ont récemment vu leur image, voire leur performance boursière, affectées à la suite d’accusations ou de révélations liées au greenwashing.
1. Deutsche Bank / DWS : l’affaire qui a déclenché une enquête mondiale
En 2022, une filiale de Deutsche Bank, DWS, a été accusée par son ancienne directrice du développement durable d’avoir surestimé les actifs véritablement durables dans ses portefeuilles. L’affaire a provoqué des perquisitions dans les bureaux de la banque à Francfort par les autorités allemandes, ainsi qu’une enquête conjointe des régulateurs américains et européens.
👉 [Source]
2. TotalEnergies : l’ONG Greenpeace contre la “neutralité carbone”
En 2023, Greenpeace France a publié une contre-enquête sur les déclarations de neutralité carbone de TotalEnergies, affirmant que l’entreprise “exagère considérablement” ses réductions d’émissions. Le rapport pointait notamment l’exclusion de certaines émissions indirectes de ses rapports climat.
👉 Source : Greenpeace – Neutralité carbone : TotalEnergies dans le flou
L’entreprise a vu son Plan Climat remis en question lors de son AG, avec des actionnaires demandant plus de transparence.
👉 Source : Le Monde – TotalEnergies : la fronde monte
3. Shell : publicités jugées trompeuses au Royaume-Uni
En 2023, l’Advertising Standards Authority (ASA) britannique a interdit une campagne de Shell mettant en avant ses initiatives « vertes », jugeant que celles-ci masquaient la réalité de son activité fossile dominante. Cette décision s’inscrit dans un tournant réglementaire : toute communication environnementale est désormais soumise à un principe d’équilibre et de représentation fidèle.
👉 [Source]
4. HSBC : greenwashing dans la finance durable
En 2022, HSBC a été sanctionnée pour une publicité vantant son implication climatique, sans mentionner les milliards investis simultanément dans les énergies fossiles. L’ASA (Advertising Standards Authority) a tranché : toute communication doit refléter l’ensemble de l’impact environnemental de l’entreprise, et non uniquement ses aspects positifs.
👉 [Source]
5. Affaire H&M et sa ligne “Conscious”
L’affaire H&M et sa ligne “Conscious”, sanctionnée en 2022 pour manque de clarté sur ses affirmations écologiques, a marqué un tournant. La sanction ne fut pas seulement juridique : elle fut réputationnelle.
👉 [Source]
Ces cas emblématiques démontrent que la sanction ne vient plus uniquement des consommateurs, mais des régulateurs, des actionnaires et des médias. Ils signalent aussi une évolution du cadre juridique : les allégations environnementales deviennent un domaine de conformité à part entière, au même titre que les états financiers.
Un risque juridique majeur : vers une régulation de la preuve
La Directive européenne sur les Green Claims, adoptée en 2024, impose une obligation de preuve scientifique pour toute allégation environnementale, y compris les plus simples (“produit recyclable”, “réduction d’émissions”, etc.). Les entreprises devront désormais fournir une base méthodologique robuste, fondée sur des normes ISO ou sur des analyses de cycle de vie (ACV), pour justifier leur communication.
Les sanctions prévues sont considérables : jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel global, avec des mécanismes de sanctions transfrontaliers dans toute l’Union européenne.
La Suisse, bien que non membre de l’UE, aligne progressivement ses pratiques. Depuis janvier 2025, la loi sur la concurrence déloyale sanctionne celui ou celle qui «donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations concernant l’impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables»[Source]. cf. la directive de la Commission Suisse pour la Loyauté [source].
Des consommateurs surinformés et défiants
L’époque où l’on pouvait berner un public avec un storytelling bien ficelé est révolue. Les consommateurs sont devenus experts, vigilants et interconnectés. Les consommateurs mondiaux questionnent de plus en plus les marques sur leur transparence concernant leur impact environnemental.
- En Suisse, une enquête de GfK publiée en 2024 révèle que plus de la moitié des citoyens jugent les engagements environnementaux des marques comme étant exagérés ou non crédibles. [Source]
- Le “name & shame” sur les réseaux sociaux (@PerledeGreenwashing, @Greenwashing news)est devenu une menace tangible pour les marques. Une erreur ou une imprécision peut être rapidement amplifiée, détériorant la réputation d’une entreprise en quelques heures. Pour en savoir plus, un article intéressant de Bon Pote sur l’efficacité du name & shame, à lire ici.
Dans ce contexte, la confiance ne se décrète plus, elle se construit à partir de preuves tangibles, de chiffres contextualisés, et d’une communication honnête sur les limites autant que sur les progrès.
Des investisseurs de plus en plus exigeants
Le tournant ESG s’est accéléré. Depuis 2022, 70 % des sociétés de capital-investissement incluent l’ESG dans leurs stratégies de création de valeur [source].
Les acteurs du capital exigent des preuves tangibles des engagements RSE. Les rapports d’impact, les données auditées, les indicateurs ESG structurés deviennent des pièces incontournables dans les due diligences.
👉 Une étude de PwC Global Investor Survey 2023 indique que 83 % des investisseurs veulent que les entreprises disent clairement où elles en sont dans leur transition durable, et non pas où elles aimeraient être [source].
Passer de l’intention à la preuve : les fondations d’une communication responsable
Dans ce nouveau paradigme, une question stratégique s’impose : comment communiquer efficacement sans tomber dans le piège du greenwashing ? Voici les trois piliers d’une approche fondée sur la preuve.
1. Mesurer avant de communiquer : le socle méthodologique
La première exigence est méthodologique : aucune communication ne peut précéder la mesure. Cela implique :
- Des données chiffrées, issues d’ACV, de bilans carbone (certifiés selon le GHG Protocol ou ISO 14067), ou de KPIs RSE audités.
- Des labels indépendants, comme B Corp, Ecolabel, Cradle to Cradle, ou FairTrade, qui apportent une reconnaissance tierce.
- Un système de gouvernance des données, garantissant leur traçabilité et leur cohérence sur tous les supports.
👉 Exemple concret : L’Oréal publie un “Product Environmental & Social Impact Labelling”, avec une note environnementale pour chaque produit, basée sur 14 critères d’ACV. Cette approche permet une transparence lisible et comparative [source][source].
2. Mettre le chiffre en contexte : pédagogie et humilité
Un chiffre brut ne suffit pas. Il doit être contextualisé, comparé, expliqué. L’honnêteté intellectuelle devient un levier de crédibilité.
Dire “nos émissions ont baissé de 20 %” est utile. Dire “elles sont passées de 10 000 tCO2e à 8 000 tCO2e entre 2022 et 2023, avec un objectif de 6 000 tCO2e en 2026, malgré une croissance de 18 % du chiffre d’affaires” est bien plus puissant.
👉 Illustration : Patagonia publie des analyses critiques de ses résultats RSE dans son rapport annuel, expliquant ses progrès mais aussi ses échecs. Cette transparence radicale est devenue une source de différenciation profonde (rapport 2023).
3. Centraliser les preuves dans un référentiel : le rapport d’impact
Le rapport d’impact, ou rapport de durabilité, devient le centre de gravité de toute communication responsable. Il doit répondre à trois fonctions :
- Documentaire : centraliser les données environnementales, sociales et de gouvernance.
- Narrative : structurer un récit clair sur la trajectoire de transformation.
- Stratégique : servir de fondation à toutes les communications futures, y compris marketing, internes, RH ou financières.
De plus en plus d’entreprises leaders publient chaque année un rapport d’impact consolidant toutes leurs données environnementales, sociales et de gouvernance. Ce document devient ainsi :
- Un outil de pilotage stratégique (KPIs environnementaux, roadmap de réduction)
- Une référence unique pour les parties prenantes internes (comex, RH, RSE)
- Un levier de crédibilité dans la communication externe (relations presse, campagnes, site web, documentation investisseurs)
👉 Exemple : le nouveau rapport des transports publics geneveois [lien]
Conclusion : la confiance comme actif stratégique
Pour les dirigeants, la question n’est plus “Faut-il prendre la parole sur l’impact environnemental ?”, mais “Comment le faire avec crédibilité, cohérence et intelligence stratégique ?”. Dans un environnement où la confiance est devenue une monnaie rare et précieuse, la communication ne peut plus se limiter à des déclarations d’intention. Elle doit s’ancrer dans la preuve, s’articuler autour de la transparence et refléter un engagement mesurable.
À l’ère de la transparence algorithmique, des whistleblowers institutionnels, des exigences réglementaires croissantes (CSRD, Green Claims Directive) et d’un public surinformé et activiste, la communication environnementale devient un exercice de haute précision. Ce qui était autrefois perçu comme un levier d’image est désormais un outil de gouvernance. Elle peut fragiliser une entreprise ou, au contraire, lui permettre de prendre une position de leadership éclairé.
La communication de la preuve n’est ni un luxe, ni un exercice cosmétique. Elle constitue :
- un impératif réglementaire dans le cadre européen et international,
- un levier de différenciation dans des marchés saturés de promesses creuses,
- un socle de résilience face aux crises réputationnelles,
- et un avantage concurrentiel dans la guerre des talents, de l’attention et du capital.
Face à des consommateurs plus exigeants que jamais, à des investisseurs qui intègrent les critères ESG dans leur allocation de capital et à des collaborateurs en quête de sens, la transparence devient un indicateur de maturité stratégique. Elle influence non seulement l’image de marque, mais aussi la capacité à nouer des partenariats durables, à recruter des profils à forte valeur ajoutée et à maintenir un haut niveau de confiance sur le long terme.
Communiquer la preuve, c’est :
- Réduire les risques juridiques et réputationnels,
- Prévenir les crises liées aux accusations de greenwashing,
- Valoriser les efforts réels d’innovation environnementale,
- Stimuler l’engagement des parties prenantes internes et externes.
Cela suppose une approche structurée, alignée avec les enjeux business et les objectifs ESG, mais aussi une capacité à documenter, auditer et contextualiser chaque message. Car la sincérité ne se proclame pas — elle se démontre.
Les entreprises qui réussiront demain ne seront pas celles qui communiquent le plus, mais celles qui donnent à voir ce qu’elles mesurent, améliorent et partagent avec rigueur. Dans un monde post-greenwashing, la performance environnementale ne peut plus être un sujet à part : elle est au cœur de la performance globale.